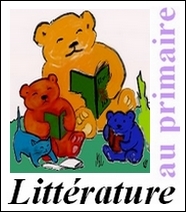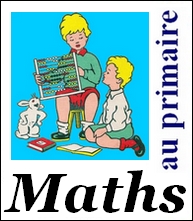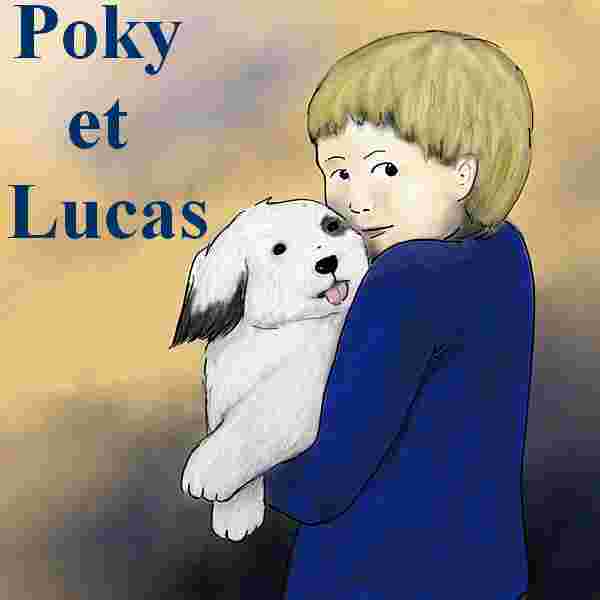-
La dictée à l'adulte : la rédaction à l'école maternelle
Catherine Huby (Blog Bienvenue chez les P'tits) :Je ne sais pas si c'est ma longue période freinétiste ou quoi, mais je n'ai rien, mais alors absolument rien contre la dictée à l'adulte collective ou individuelle que je pratique assez régulièrement dans ma classe et que je pratiquerais sans doute encore bien plus si j'avais une Petite ou Moyenne Section.En effet, il me semble que c'est un excellent moyen de « faire entrer dans le monde de l'écrit » un enfant qui ne sait encore ni lire, ni écrire sans lui «pomper l'air» avec d'interminables séquences sur l'album du trimestre et le tri de textes qui ne le concernent en rien.
http://www.paragonfineart.com/artists/rob-gonsalves.html En premier lieu, parce que, nous le savons tous, le petit enfant est encore incapable de se décentrer et d'observer le monde à travers d'autres lunettes que les siennes, dans mes classes maternelles, nous commencions toujours le «travail écrit» par un moment de dessin libre. Quand il a fallu que je colle des objectifs et des compétences visées là-dessus, je marquais : motricité fine, initiation à l'expression écrite. Je sais, c'est nul, mais je n'ai jamais compris ce morcellement de la croissance intellectuelle en petites unités de valeur.Ensuite, chaque enfant me racontait son dessin et mon travail de secrétaire-traducteur commençait alors ; il s'agissait de transcrire d'abord les « watu » en voitures, les « madam' » en dames, les « changuillé » en sanglier ou cendrier, selon le contexte et le vécu familial de chaque bambin de deux ou trois ans, et de faire répéter patiemment le mot un peu plus correctement.Pour les plus grands, il fallait les pousser à faire des phrases : « Tu me dis la maison, la voiture, le soleil. C'est bien, mais je vois tout ça. Moi, ce que je veux écrire, c'est ton histoire, ta phrase, ce que tu veux raconter. Dans les livres, ils racontent des histoires, ils ne nous disent pas la princesse, le roi, le loup ; tout ça, nous le voyons sur l'image, alors ils nous racontent ce que font les personnages. C'est ce que je veux que tu me dises et moi, je l'écrirai sur ton dessin. ». Cela prenait généralement une semaine ou deux en fin de Petite Section ou en début de Moyenne Section (cette année, avec mes Grandes Sections, ça a été réglé en deux ou trois dessins).La troisième phase de cette « discipline » permettait de travailler deux nouveaux approfondissements : la correction du français et la sortie du « Moi, à ma maison, j'ai... ». C'était l'époque de la Grande Section le plus souvent, mais il arrivait que déjà, chez les Moyens, certains enfants en arrivent à ce stade, celui où l'on corrige les « il disa », il « faisa », « il faut qu'il prend » et autres « j'eurai » ; celui où l'on encourage l'enfant à enrichir ses phrases de détails pertinents qui permettraient de se passer du dessin pour comprendre.Celui où l'enfant ne s'intéresse plus seulement à lui et où il ressent la nécessité de se servir du dessin pour relater des événements, des apprentissages ou pour résumer les contes que la maîtresse a lus. Au besoin celle-ci poussait les moins ouverts d'entre eux vers ces nouvelles pistes.Une nouvelle organisation prenait alors forme : il était nécessaire de partager le travail entre les différents élèves car aucun dessin ne pouvait permettre de représenter toute la chronologie des événements ; bien sûr, au début de ce stade, nous pouvions nous contenter de la bande dessinée, chaque enfant représentait sur une feuille partagée en trois ou quatre cases le déroulement de l'histoire. Mais bien vite, la complexité ou la longueur du conte ne le permettait plus, il fallait se répartir les tâches.Ainsi l'écrit commençait à précéder le dessin figuratif : en effet, il nous fallait une base de travail, une mémoire qui permettrait de répartir le travail en autant d'épisodes qu'il y avait d'enfants. La maîtresse jouait toujours son rôle de secrétaire, souvent même les écrits restaient sur ses genoux ou son bureau et c'était elle qui les relisait.Il arrivait même que le dessin disparaisse, l'écrit produit se suffisant à lui-même : lettres aux parents ou à un petit camarade malade, articles pour la gazette communale ou le journal d'école, liste de matériel à collecter ou à préparer.Tous ces écrits faisaient l'objet de « leçons » sur ce que l'on peut écrire, ce que l'on peut dire et comment le dire, des leçons de grammaire en quelque sorte, avec leurs révisions fréquentes, leurs règles à apprendre et à réutiliser (un cheval / des chevaux ; nous ... ons ; il / elle). Le vocabulaire s'enrichissait lui aussi : il fallait se débrouiller pour réemployer les mots « rares » du conte que nous voulions raconter ou ceux qui avaient été appris pendant la leçon de choses.Les bonnes années, en fin de GS, la plupart des enfants étaient suffisamment prêts pour que ces textes, écrits au tableau, soient composés collectivement au point de vue orthographique, au moins au niveau des mots simples et des règles de base (le « s » du pluriel, le « e » du féminin, le « est » du verbe être ou la conjonction de coordination « et », etc.).Ces exercices ne prenaient jamais plus d'une demi-heure dans la journée, le reste du temps, ils apprenaient à écrire, à compter, à s'orienter, à s'exercer en sport, en musique, en travaux manuels, écoutaient des histoires, en retenaient le vocabulaire, jouaient avec leurs camarades, construisaient et démontaient des jeux, des objets, écoutaient de la musique, observaient des images ou des objets, enfin, tout ce que l'on peut faire lorsque l'on est en classe et que l'on a tout à apprendre.Actuellement, je reçois en GS des élèves qui ont fréquenté pendant deux ou trois ans une classe maternelle.Souvent, ils savent à peine dessiner, certains ne savent même pas du tout, ils ont beaucoup de peine à m'écouter et ignorent totalement qu'ils sont aussi censés écouter leurs camarades. Il m'est donc impossible de commencer la dictée à l'adulte au stade où je la débutais lorsque la maternelle savait les faire sortir de leur égocentrisme et exercer leurs capacités d'observation et d'expression graphique et orale.Je combine donc un résumé des activités citées plus haut avec une imprégnation à la rédaction plus formelle. Cette année, c'est allé assez vite, les enfants sont vifs et volontaires. L'année dernière, le groupe était moins homogène, plus « poupouce-canapé », certains petits garçons avaient déjà conclu que le temps scolaire était une immense mi-temps aride et insipide entre deux moments de récréation et il a vraiment fallu que je déploie des trésors d'imagination, de contrainte et de récompenses pour obtenir des futurs élèves de CP, prêts à sortir de leur « berceau mental » pour enfin profiter des lumières de la Culture.Dans mes classes, il n'a jamais été question de remplir les petites cases d'un quelconque livret d'évaluation afin de statuer sur la compétence de Pierre ou de Paul à « restaurer la structure syntaxique d'une phrase non grammaticale » ou à « proposer une amélioration de la cohésion du texte (pronominalisation, lien de connexion) ».Je n'y ai jamais pensé ou alors j'y ai toujours tellement pensé, à chaque nouveau texte, que je considérais qu'il n'y avait rien à évaluer ; sans doute suis-je une très mauvaise « médiatrice » entre l'enfant et les apprentissages et imposé-je un « modèle adulte trop prégnant » !Lorsqu'un tout petit me dit pour raconter son dessin : « Papa... Changuillé... a fusil... Pan ! », je ne me précipite pas sur son cahier d'évaluation pour cocher la case « non acquis » et je me contente bêtement de prendre mon stylo et d'écrire sur sa feuille sous son dessin en lui disant (trois fois : oral, écriture, relecture) : « Papa a pris son fusil et il a tiré sur le sanglier ! Pan ! », j'en rajoute même une couche dans l'intrusion voulue et calculée au cœur de son processus de construction des savoirs en demandant : « Et alors, l'a-t-il tué ce sanglier ? Est-il mort ? » et j'insiste lourdement pour que l'enfant apprenne qu'après la situation initiale, la force perturbatrice et l'action, on finit forcément par énoncer la force rééquilibrante et la situation finale, non mais !Ecrit par : catmano | 14 novembre 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------D'autres textes de Catherine Huby :
- Nuls en maths : les errances de la maternelle concernant le calcul
- Revoir les nombres de 1 à 100 en CE1
- Méthode de lecture CP : Ecrire et lire au CP
- L'apprentissage des gestes de l'écriture liée et Enseigner l'écriture liée de la PS au CP
- La dictée à l'adulte : la "rédaction à l'école maternelle
- B-A, BA et apprentissage de la langue (L'utilisation de Borel-Maisonny n'est pas dangereuse pour la santé, bien au contraire)
- Lecture : le régime enrichi
- Constructivisme vs. "tu le sais, toi, maîtresse ? alors t'y as qu'à nous le dire, ça ira plus vite ? Le constructivisme et la main à la pâte sont les deux mamelles de l'échec scolaire en science, telle est la thèse défendue par Catherine Huby dans ce texte polémiquement jouissif.
- Pauvre Shéhérazade ! A propos de l'article "L’écrit douloureux de Shéhérazade, candidate à l’enseignement" (blog Interro écrite) qui montre les difficultés de maîtrise de la langue française d'une étudiante préparant les concours de professeur des écoles, Catherine Huby propose un commentaire passionnant.
- Lecture en grande section : présentation du manuel de Thierry Venot, De l'écoute des sons à la lecture (GS).
- L'école maternelle : une proposition de programme d'enseignement ambitieux pour l'école maternelle.
- Se Repérer, Compter, Calculer en grande section (fiches et livre du maître pour la grande section)
- Manuel Compter, Calculer au CE1
- La conjugaison et l'EPS
- Refondation : tout commence avec l'école maternelle
- L'Alphabet en maternelle
 Tags : dictée à l adulte, catherine huby
Tags : dictée à l adulte, catherine huby
-
Commentaires
Élocution, vocabulaire, rédaction